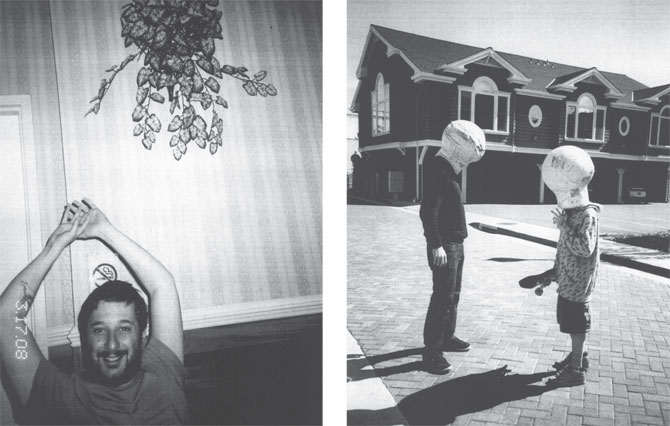
Publicité
Ari Marcopoulos : Mes débuts dans la photographie, c’était quand j’étais gosse. Mon père revenait d’un voyage au Japon et il m’a ramené un appareil Asahi Spotmatic. Je l’adorais. Je prenais des milliers de photos – je prenais surtout le circuit automobile à côté de chez moi et puis ma copine, aussi. J’étais du genre à errer dans la ville pour photographier tout ce qui me semblait intéressant.Donc c’est comme ça que tu t’y es initié ?
Ouais, voilà. J’ai aussi appris a développer mes pellicules dans une chambre noire, au sous sol, chez mes parents. Je trouvais ça magique.Tu avais en tête de faire carrière ?
Pas vraiment, mais c’est venu au fur et à mesure. Carrière est un grand mot. Je n’ai jamais vraiment pensé « carrière ». Mon premier vrai projet consistait à tirer le portrait de musiciens et d’artistes, et j’en ai fait mon premier book.Tu l’as fait après ton arrivée à New York ?
Ouais. J’ai quitté la Hollande pour New York en 1979. Je ne connaissais pas grand-chose de New York mais j’adorais les gratte-ciel et les converses All Stars, alors y aller m’a paru être un bon compromis. Je voulais y travailler six mois et retourner chez moi. Mais trente ans plus tard, j’y suis encore. C’est cool que tout ait aussi bien marché pour moi, l’énergie qui émanait de New York m’a été bénéfique. Aujourd’hui, c’est différent. Les gens romancent beaucoup trop le passé, surtout quand il s’agit de New York et des années 1980. C’était bien, et ça l’est toujours, mais différemment.
Publicité
Oui, je lui imprimais ses photos en noir et blanc. C’était pas grand-chose. Les gens ont tendance à penser que ça rapportait énormément, mais c’était extrêmement mal payé. J’étais sans le sou, et j’avais besoin de thunes pour survivre. La plupart du temps, je vagabondais et prenais des photos, vu que je n’avais pas grand-chose d’autre à foutre.On dirait que tes photos s’intéressent aux inégalités de toutes sortes. C’est un sujet qui te tient particulièrement à cœur ?

Je les ai aperçus sous le pont de Brooklyn un jour, et un de mes potes, Dave Aron, m’a présenté à Jeff Pang. Quand j’ai traîné avec Jeff et Harold Hunter pour la première fois, le courant est tout de suite passé.
Publicité
Ouais, carrément. On s’est liés d’amitié tout de suite, façon Nescafé. Je m’en sors plutôt bien quand il s’agit de se sociabiliser. Je suis de nature avenante.Comment Directory a vu le jour ?
C’est quelque chose que j’avais en tête depuis des années ; il fallait juste trouver le moyen de le concrétiser. Après avoir longtemps stagné au stade des planifications, Rizzoli a accepté de le publier, mais ça n’a pas été chose facile ; mon livre n’est pas vraiment ce qu’on peut appeler du Rizzoli classique.Quelles ont été leurs réactions quand tu leur as dit que tu voulais publier ça sous forme d’annuaire ?
Les éditeurs avec qui je bossais ont tout de suite compris l’idée, et m’ont soutenu. Le seul problème, c’était Rizzoli ; il s’agit d’une grosse boîte, avec beaucoup de gens à convaincre, surtout que l’économie américaine battait de l’aile à cette époque. Par chance, ils ont été cool et tout le monde m’a donné sa bénédiction. Mais ça a mis du temps. C’est parti d’une vieille idée, et ça a pris plus d’un an à se faire. J’ai tout scanné et photocopié moi-même.Pourquoi tu aimes tant photocopier ?
Ça rend le travail plus simple. C’est comme ça que j’ai réussi à travailler à mes débuts. J’ai aussi été habitué à éditer les livres avant la révolution numérique et le post-traitement ; mais ce n’est pas la seule technique d’impression que j’utilise.
Publicité
Le terme « annuaire » se réfère plus au format qu’au contenu. Le livre est une retranscription approximative de la pollution visuelle qui nous envahit chaque jour. Ces choses qu’on voit mais qu’on ne contrôle pas ; les magazines, la signalisation, les publicités que l’on voit sur les photos des gens que j’ai rencontrés pendant mes séjours à New York.C’est une critique ?
Je ne considère pas ça comme quelque chose de mal, donc c’est pas vraiment une critique. C’est la bande son de ta vie. Ce n’est pas recherché, ni composé.Plus de fanzines :SE BALADER A POIL DANS LES HÔTELS – Un couple de branleurs qui squattent des chambres avec des litsTOUT VA BIEN, NATHANIEL RUSSEL N’A PAS VRAIMENT PERDU SON CHIEN