PHOTOS AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE LAURENT TIXADOR J’ai découvert le boulot de Tixador en 2008 dans une expo à l’Espace Ricard. Je me suis retrouvé planté devant une vidéo où deux mecs équipés comme des mineurs s’employaient à creuser un tunnel à 20 mètres sous terre. J’ai appris plus tard que Laurent Tixador et Abraham Poincheval étaient des légendes vivantes à Nantes et bien au-delà. Leur credo : tenter ce qu’ils ne savent pas faire ou qu’ils n’ont jamais fait, sans entraînement ni préparation.Petit récapitulatif de leurs aventures : invités à participer à une exposition sur l’île du Frioul en 2001, leur première performance consiste à vivre en autarcie pendant une semaine dans un environnement inconnu. Bilan : ils se font attaquer par des rats, crèvent la dalle et finissent par exécuter des peintures rupestres figurant des logos de M&M’s et de Quick. En 2002, les compères se lancent dansL’Inconnu des Grands Horizons, une expédition dérisoire qui consiste à relier Nantes à Metz à pied et en ligne droite, équipés seulement d’une boussole. À deux reprises, Tixador franchira le cercle arctique : la première fois pour y faire naviguer un iceberg en plastique télécommandé, la deuxième pour atteindre le pôle Nord. Sauf que l’aventure au XXIe siècle s’avère nettement moins épique queL’Iliadeet Tixador en chie des rondelles tout du long. Il y aura bien d’autres péripéties : un périple cycliste jusqu’à Verdun qui se soldera par une défaite, un combat nocturne dans une pièce infestée de moustiques, un camping sur les toits d’un building coréen, un enfermement volontaire dans une geôle sordide, un campement troglodyte au beau milieu d’une prairie.Depuis trois ans, Tixador fait cavalier seul, son compère Poincheval ayant vogué vers de nouveaux horizons. En 2009, il filme une sorte de jeu de rôle grandeur nature dans une caserne abandonnée. La même année, pendant toute la durée de la FIAC, il s’enferme dans une étrange construction en bois sur pilotis bâtie au milieu des Tuileries. Dernièrement, il a achevé de construire un blockhaus dans une galerie en Bretagne : une énorme protubérance en béton aveugle qui excède les proportions de la galerie, au point que l’on se demande si celle-ci n’a pas été érigée postérieurement à la gigantesque bâtisse. Pourquoi ? Pour rien.As-tu eu envie dès le départ de travailler sur des situations éphémères plutôt que sur des œuvres pérennes ?Durant mes études à l’École des beaux-arts je cherchais déjà à provoquer des situations plutôt qu’à faire de l’art à tout prix. Je n’ai jamais envisagé d’autres façons de travailler. Il me semble que le travail d’un artiste est une quête de l’indéfini. J’ai mis en place ma façon de fonctionner petit à petit, sans vraiment réfléchir à ce que je devais faire mais plutôt à ce que j’avais envie de faire. Ça ne s’est pas déclenché tout à coup, à un moment précis. En revanche, j’ai remarqué que pendant la période qui précède une action, enfin plutôt à partir du moment où une nouvelle envie se déclenche, je sens mon comportement devenir obsessionnel. Je n’attends plus qu’une chose, c’est l’opportunité de réaliser ce projet qui m’habite du matin au soir. Cela devient une idée fixe qui conditionne mon existence comme pour le capitaine Achab dansMoby Dick, dont je partage le côté à la fois obsessionnel et méthodique. C’est seulement quand je suis dans l’action que je peux enfin lâcher les rênes et me laisser complètement manipuler par mon nouvel environnement avec la légèreté d’Ismaël, le narrateur qui ne mesure rien du projet dramatique dans lequel il s’engage.Je vois.Les meilleures expositions sont celles qu’on n’a pas besoin de voir. S’il suffit d’un descriptif sommaire pour étonner et toucher quelque chose en chacun de nous, c’est largement suffisant. La plupart des actions que j’ai réalisées ont eu un retentissement plus grand dans les discussions que dans les salles d’exposition. C’est d’ailleurs très dur d’en rendre compte matériellement car les objets que j’en tire sont largement inadaptés à la présentation dans un lieu d’art. Ce sont juste des souvenirs qui sont censés orner ma cheminée.
J’ai découvert le boulot de Tixador en 2008 dans une expo à l’Espace Ricard. Je me suis retrouvé planté devant une vidéo où deux mecs équipés comme des mineurs s’employaient à creuser un tunnel à 20 mètres sous terre. J’ai appris plus tard que Laurent Tixador et Abraham Poincheval étaient des légendes vivantes à Nantes et bien au-delà. Leur credo : tenter ce qu’ils ne savent pas faire ou qu’ils n’ont jamais fait, sans entraînement ni préparation.Petit récapitulatif de leurs aventures : invités à participer à une exposition sur l’île du Frioul en 2001, leur première performance consiste à vivre en autarcie pendant une semaine dans un environnement inconnu. Bilan : ils se font attaquer par des rats, crèvent la dalle et finissent par exécuter des peintures rupestres figurant des logos de M&M’s et de Quick. En 2002, les compères se lancent dansL’Inconnu des Grands Horizons, une expédition dérisoire qui consiste à relier Nantes à Metz à pied et en ligne droite, équipés seulement d’une boussole. À deux reprises, Tixador franchira le cercle arctique : la première fois pour y faire naviguer un iceberg en plastique télécommandé, la deuxième pour atteindre le pôle Nord. Sauf que l’aventure au XXIe siècle s’avère nettement moins épique queL’Iliadeet Tixador en chie des rondelles tout du long. Il y aura bien d’autres péripéties : un périple cycliste jusqu’à Verdun qui se soldera par une défaite, un combat nocturne dans une pièce infestée de moustiques, un camping sur les toits d’un building coréen, un enfermement volontaire dans une geôle sordide, un campement troglodyte au beau milieu d’une prairie.Depuis trois ans, Tixador fait cavalier seul, son compère Poincheval ayant vogué vers de nouveaux horizons. En 2009, il filme une sorte de jeu de rôle grandeur nature dans une caserne abandonnée. La même année, pendant toute la durée de la FIAC, il s’enferme dans une étrange construction en bois sur pilotis bâtie au milieu des Tuileries. Dernièrement, il a achevé de construire un blockhaus dans une galerie en Bretagne : une énorme protubérance en béton aveugle qui excède les proportions de la galerie, au point que l’on se demande si celle-ci n’a pas été érigée postérieurement à la gigantesque bâtisse. Pourquoi ? Pour rien.As-tu eu envie dès le départ de travailler sur des situations éphémères plutôt que sur des œuvres pérennes ?Durant mes études à l’École des beaux-arts je cherchais déjà à provoquer des situations plutôt qu’à faire de l’art à tout prix. Je n’ai jamais envisagé d’autres façons de travailler. Il me semble que le travail d’un artiste est une quête de l’indéfini. J’ai mis en place ma façon de fonctionner petit à petit, sans vraiment réfléchir à ce que je devais faire mais plutôt à ce que j’avais envie de faire. Ça ne s’est pas déclenché tout à coup, à un moment précis. En revanche, j’ai remarqué que pendant la période qui précède une action, enfin plutôt à partir du moment où une nouvelle envie se déclenche, je sens mon comportement devenir obsessionnel. Je n’attends plus qu’une chose, c’est l’opportunité de réaliser ce projet qui m’habite du matin au soir. Cela devient une idée fixe qui conditionne mon existence comme pour le capitaine Achab dansMoby Dick, dont je partage le côté à la fois obsessionnel et méthodique. C’est seulement quand je suis dans l’action que je peux enfin lâcher les rênes et me laisser complètement manipuler par mon nouvel environnement avec la légèreté d’Ismaël, le narrateur qui ne mesure rien du projet dramatique dans lequel il s’engage.Je vois.Les meilleures expositions sont celles qu’on n’a pas besoin de voir. S’il suffit d’un descriptif sommaire pour étonner et toucher quelque chose en chacun de nous, c’est largement suffisant. La plupart des actions que j’ai réalisées ont eu un retentissement plus grand dans les discussions que dans les salles d’exposition. C’est d’ailleurs très dur d’en rendre compte matériellement car les objets que j’en tire sont largement inadaptés à la présentation dans un lieu d’art. Ce sont juste des souvenirs qui sont censés orner ma cheminée. Parmi toutes les expériences que tu as vécues, lesquelles t’ont le plus marqué ?Elles sont tellement hétéroclites qu’elles m’ont toutes marqué pour des raisons différentes. Mais je dois dire que la seule fois où j’ai pleuré tellement j’en avais marre, c’est en allant au pôle Nord. On faisait huit heures par jour de ski sur la banquise et parfois plus parce qu’on avait pris du retard dès le départ. Comme il faisait entre -30° et -40°, on ne pouvait s’autoriser que des pauses de cinq minutes toutes les heures pour manger une barre de céréales avant de se refroidir. Et on repartait. C’est pendant une de ces pauses que je me suis retrouvé en larmes, j’ai subitement pris conscience de l’impossibilité de me tirer de cette galère avant la fin. Le pire, c’est que si j’avais pu abandonner en route, j’aurais eu de bonnes raisons de pleurer après.Ouais. Tu as aussi expérimenté l’enfermement dans un cachot à deux reprises, pendant vingt jours d’affilée. Qu’est-ce que tu as ressenti ?Une folie : les premières heures étaient un peu déconcertantes mais très rapidement, du fait de ma solitude, mon cerveau a compensé tout ce dont l’environnement me privait. J’ai eu la visite d’une multitude de personnages imaginaires. Il y a d’abord eu la femme nue qu’on voit sur tous les murs de prison. Ensuite est arrivé Livingstone avec ses récits colonialistes, suivi de Rimbaud, Pappy Boyington et Dora l’exploratrice, mais adulte. Une espèce de roman insensé se déroulait dans ma tête si rapidement que j’avais à peine le temps de tout noter.Comment tu passais le temps, sinon ?J’ai fabriqué un stylo à plume pour écrire toutes ces histoires en utilisant du Ricoré comme encre mais c’était trop lent et il a fallu que je détache du plâtre des parois pour prendre des notes sur le sol de ma cellule. Quand je n’écrivais rien, je bricolais des trucs en papier toilette ou en opercules d’aluminium. En définitive, il est arrivé plusieurs fois que je me retrouve dépassé par mon planning de la journée. Étonnamment, il n’a jamais été question d’ennui dans cet endroit mais plutôt de suractivité. Je n’aurais jamais imaginé ça possible avant de l’avoir vécu. Un vrai récit d’aventures contenu dans douze mètres carrés. C’est sensiblement ce qui a dû arriver à Xavier de Maistre quand il a écritVoyage autour de ma chambre. Comme lui, je peux dire que « ma bête » a pris le dessus sur mon esprit. C’est rare, mais bon.Combien de temps tu es resté avec ton acolyte Poincheval dans le tunnel ? Là encore, des plombes.C’est resté à l’état de projet assez longtemps jusqu’au jour où Nicolas Bourriaud nous a proposé de le réaliser en Espagne pour la Biennale de Murcia. Le projet initial était de creuser 20 mètres en vingt jours, mais la terre était si dure qu’on est juste parvenus péniblement à faire 8,50 mètres. On pourrait dire que ce n’est pas très impressionnant comme progression en vingt jours, mais c’est le voyage le plus dépaysant que j’aie jamais fait.Et à l’intérieur, c’était comment ?J’avais déjà eu une pratique de l’archéologie et de la spéléologie, je me disais que je connaissais déjà le contexte dans lequel nous serions enfermés mais bon, j’ai été naïf de penser ça. C’est comme si l’on voyageait dans la mort. Je m’attendais seulement à des angoisses liées aux éboulements ou à la fatigue physique mais sûrement pas à en venir à me demander si c’est possible de monter au ciel en cas d’accident dans une bulle souterraine. C’est bien la seule fois où je me suis senti devenir ésotérique.Ouais, enfin, tes visions dans la cellule avaient l’air tout aussi ésotériques. Tu as juste eu besoin d’un temps d’adaptation, si je comprends bien ?Oui, à partir du troisième ou quatrième jour, toutes ces angoisses ont disparu et j’ai enfin pu tirer parti de la situation, ou plutôt du caractère rarissime de la situation. Je me suis débarrassé d’une sorte de mue constituée de toutes les habitudes prises à la surface. À partir de ce moment, je n’ai été obsédé que par une seule chose : profiter pleinement de la situation. C’était un véritable voyage intérieur.
Parmi toutes les expériences que tu as vécues, lesquelles t’ont le plus marqué ?Elles sont tellement hétéroclites qu’elles m’ont toutes marqué pour des raisons différentes. Mais je dois dire que la seule fois où j’ai pleuré tellement j’en avais marre, c’est en allant au pôle Nord. On faisait huit heures par jour de ski sur la banquise et parfois plus parce qu’on avait pris du retard dès le départ. Comme il faisait entre -30° et -40°, on ne pouvait s’autoriser que des pauses de cinq minutes toutes les heures pour manger une barre de céréales avant de se refroidir. Et on repartait. C’est pendant une de ces pauses que je me suis retrouvé en larmes, j’ai subitement pris conscience de l’impossibilité de me tirer de cette galère avant la fin. Le pire, c’est que si j’avais pu abandonner en route, j’aurais eu de bonnes raisons de pleurer après.Ouais. Tu as aussi expérimenté l’enfermement dans un cachot à deux reprises, pendant vingt jours d’affilée. Qu’est-ce que tu as ressenti ?Une folie : les premières heures étaient un peu déconcertantes mais très rapidement, du fait de ma solitude, mon cerveau a compensé tout ce dont l’environnement me privait. J’ai eu la visite d’une multitude de personnages imaginaires. Il y a d’abord eu la femme nue qu’on voit sur tous les murs de prison. Ensuite est arrivé Livingstone avec ses récits colonialistes, suivi de Rimbaud, Pappy Boyington et Dora l’exploratrice, mais adulte. Une espèce de roman insensé se déroulait dans ma tête si rapidement que j’avais à peine le temps de tout noter.Comment tu passais le temps, sinon ?J’ai fabriqué un stylo à plume pour écrire toutes ces histoires en utilisant du Ricoré comme encre mais c’était trop lent et il a fallu que je détache du plâtre des parois pour prendre des notes sur le sol de ma cellule. Quand je n’écrivais rien, je bricolais des trucs en papier toilette ou en opercules d’aluminium. En définitive, il est arrivé plusieurs fois que je me retrouve dépassé par mon planning de la journée. Étonnamment, il n’a jamais été question d’ennui dans cet endroit mais plutôt de suractivité. Je n’aurais jamais imaginé ça possible avant de l’avoir vécu. Un vrai récit d’aventures contenu dans douze mètres carrés. C’est sensiblement ce qui a dû arriver à Xavier de Maistre quand il a écritVoyage autour de ma chambre. Comme lui, je peux dire que « ma bête » a pris le dessus sur mon esprit. C’est rare, mais bon.Combien de temps tu es resté avec ton acolyte Poincheval dans le tunnel ? Là encore, des plombes.C’est resté à l’état de projet assez longtemps jusqu’au jour où Nicolas Bourriaud nous a proposé de le réaliser en Espagne pour la Biennale de Murcia. Le projet initial était de creuser 20 mètres en vingt jours, mais la terre était si dure qu’on est juste parvenus péniblement à faire 8,50 mètres. On pourrait dire que ce n’est pas très impressionnant comme progression en vingt jours, mais c’est le voyage le plus dépaysant que j’aie jamais fait.Et à l’intérieur, c’était comment ?J’avais déjà eu une pratique de l’archéologie et de la spéléologie, je me disais que je connaissais déjà le contexte dans lequel nous serions enfermés mais bon, j’ai été naïf de penser ça. C’est comme si l’on voyageait dans la mort. Je m’attendais seulement à des angoisses liées aux éboulements ou à la fatigue physique mais sûrement pas à en venir à me demander si c’est possible de monter au ciel en cas d’accident dans une bulle souterraine. C’est bien la seule fois où je me suis senti devenir ésotérique.Ouais, enfin, tes visions dans la cellule avaient l’air tout aussi ésotériques. Tu as juste eu besoin d’un temps d’adaptation, si je comprends bien ?Oui, à partir du troisième ou quatrième jour, toutes ces angoisses ont disparu et j’ai enfin pu tirer parti de la situation, ou plutôt du caractère rarissime de la situation. Je me suis débarrassé d’une sorte de mue constituée de toutes les habitudes prises à la surface. À partir de ce moment, je n’ai été obsédé que par une seule chose : profiter pleinement de la situation. C’était un véritable voyage intérieur. À t’entendre, ça a l’air sympa d’être enterré vivant. Ce sentiment d’isolation et de perte de repères doit quand même être super éprouvant. Moi qui suis claustrophobe, l’idée d’un tunnel qu’on rebouche derrière soi, c’est mon pire cauchemar. Un peu comme cette histoire des Chiliens enfermés sous terre, là.La perte des repères est la chose essentielle que je cherche dans toutes ces actions et c’est bien pour cela que je ne les répète jamais, pour qu’elles continuent à être déstabilisantes, inhabituelles. C’est hyper intéressant à chaque fois de refaire évoluer son quotidien à partir de rien, d’une situation nouvelle où tout est différent, jusqu’à la façon dont on s’organise pour rétablir peu à peu une sorte de confort. Les habitudes changent, l’ergonomie aussi et au final, le comportement. Je ne sais pas trop comment ça s’est passé pour les trente-trois mineurs chiliens durant leur enfermement mais en lisant la presse, je cherchais des indices sur leur état d’esprit, leurs sentiments, pour savoir s’ils étaient suffisamment en confiance pour profiter de ce moment comme une bande de potes en cavale. Je serais curieux de savoir s’ils ont vécu ça comme une expérience initiatique ou s’ils ont juste pris leur mal en patience en attendant de pouvoir sortir.J’imagine que tu es parfois en train de te demander : « Merde, pourquoi je suis en train de faire ça ? Putain, mais qu’est-ce que je fous là ? »Bien sûr, quand tout va mal, je me demande pourquoi je ne suis pas vautré dans mon canapé avec une télécommande à la main. Mais même s’il m’arrive de considérer le contexte de l’action comme nul, voire hostile, je me dis que j’ai quand même fait beaucoup d’efforts pour y être et que j’ai sans doute de bonnes raisons de vivre ça, même si je les ai oubliées.Tu peux me dire quels ont été les obstacles les plus difficiles à surmonter lors de ta marche en ligne droite ?Dès les premiers pas de cette marche en ligne droite, j’ai réalisé que je ne savais pas où j’allais dormir une fois la nuit tombée. Ça remettait en cause un principe très simple et rassurant qui est de savoir qu’on finira la journée bien au chaud dans son lit, quelles que soient les difficultés rencontrées au cours de celle-ci. Après, il ne s’agissait plus vraiment de difficultés, mais de complications routinières liées au mode de déplacement. Chaque fois qu’un nouvel horizon se présentait à nous derrière un accident de terrain, il était précédé d’un cortège d’obstacles du genre autoroute, marais, ligne de TGV, rivière, terrain militaire ou désert agricole. Le fait de voyager en ligne droite, avec une boussole pour suivre son cap mais sans carte géographique, nous a mis à la portée d’embûches multiples que les routes évitent soigneusement. C’est de cette façon que la découverte du paysage et du territoire a pu exister pendant cette marche. Nous n’étions ni l’un ni l’autre des randonneurs rodés à la nature mais plutôt des citadins qui prennent le métro pour une seule station. C’est ça qui fait la différence avec un raid classique. Si nous nous étions soumis à un entraînement préalable, ça serait revenu à prendre un train Nantes-Metz. On aurait été de stupides machines à avaler les distances.En un sens, on peut rapprocher vos performances de concepts qui ont été popularisés par la télé-réalité : Koh-Lanta, Fear Factor, Man vs Wild… Même si les enjeux sont à l’antithèse de ça : d’un côté, il y a l’appât du gain et le bénéfice matériel, de l’autre une gratuité totale et absurde du geste, une expérience purement existentielle.La télé-réalité est intéressante parce que c’est un principe de récit qui englobe du texte (je pense aux aveux dans le confessionnal deSecret Story) en alternance avec des images autour des mêmes événements. C’est un mode de reportage idéal. Sinon, les situations sont tellement écrites, les protagonistes tellement débiles que j’ai du mal à considérer ce médium comme « intéressant ». Pour l’instant, il est entre les mains de crapules alors que c’est une forme qui a le potentiel de véhiculer bien plus de sens qu’elle n’en a à l’heure actuelle.Tu peux nous en dire plus sur ta performance intitulée Verdun ?Ce n’était pas une performance mais une expo qui portait ce nom. Dans tous les récits, on parle de Verdun comme étant synonyme de boue, de massacres, d’explosions, de météo pourrie, de tranchées… La seule chose qui subsiste encore là-bas de tout ça et qui est immuable, c’est la boue – et le temps pourri. Dans chacun des projets que j’ai menés, la survie en milieu hostile et l’adaptation à l’environnement sont facilement comparables à des situations de conflit, pourtant je n’ai jamais été franchement belliqueux ni passionné par le phénomène guerrier. Ce qui me rapproche de Verdun, c’est surtout d’être, au cours de chaque projet, victime d’un contexte. Bien sûr, c’est sans commune mesure avec ce qu’ont vécu les soldats pendant la première guerre mondiale, mais la campagne environnant Verdun est toujours terrible pour quelqu’un de perdu. C’est resté un paysage qui dévore, une terre qui engloutit les hommes.
À t’entendre, ça a l’air sympa d’être enterré vivant. Ce sentiment d’isolation et de perte de repères doit quand même être super éprouvant. Moi qui suis claustrophobe, l’idée d’un tunnel qu’on rebouche derrière soi, c’est mon pire cauchemar. Un peu comme cette histoire des Chiliens enfermés sous terre, là.La perte des repères est la chose essentielle que je cherche dans toutes ces actions et c’est bien pour cela que je ne les répète jamais, pour qu’elles continuent à être déstabilisantes, inhabituelles. C’est hyper intéressant à chaque fois de refaire évoluer son quotidien à partir de rien, d’une situation nouvelle où tout est différent, jusqu’à la façon dont on s’organise pour rétablir peu à peu une sorte de confort. Les habitudes changent, l’ergonomie aussi et au final, le comportement. Je ne sais pas trop comment ça s’est passé pour les trente-trois mineurs chiliens durant leur enfermement mais en lisant la presse, je cherchais des indices sur leur état d’esprit, leurs sentiments, pour savoir s’ils étaient suffisamment en confiance pour profiter de ce moment comme une bande de potes en cavale. Je serais curieux de savoir s’ils ont vécu ça comme une expérience initiatique ou s’ils ont juste pris leur mal en patience en attendant de pouvoir sortir.J’imagine que tu es parfois en train de te demander : « Merde, pourquoi je suis en train de faire ça ? Putain, mais qu’est-ce que je fous là ? »Bien sûr, quand tout va mal, je me demande pourquoi je ne suis pas vautré dans mon canapé avec une télécommande à la main. Mais même s’il m’arrive de considérer le contexte de l’action comme nul, voire hostile, je me dis que j’ai quand même fait beaucoup d’efforts pour y être et que j’ai sans doute de bonnes raisons de vivre ça, même si je les ai oubliées.Tu peux me dire quels ont été les obstacles les plus difficiles à surmonter lors de ta marche en ligne droite ?Dès les premiers pas de cette marche en ligne droite, j’ai réalisé que je ne savais pas où j’allais dormir une fois la nuit tombée. Ça remettait en cause un principe très simple et rassurant qui est de savoir qu’on finira la journée bien au chaud dans son lit, quelles que soient les difficultés rencontrées au cours de celle-ci. Après, il ne s’agissait plus vraiment de difficultés, mais de complications routinières liées au mode de déplacement. Chaque fois qu’un nouvel horizon se présentait à nous derrière un accident de terrain, il était précédé d’un cortège d’obstacles du genre autoroute, marais, ligne de TGV, rivière, terrain militaire ou désert agricole. Le fait de voyager en ligne droite, avec une boussole pour suivre son cap mais sans carte géographique, nous a mis à la portée d’embûches multiples que les routes évitent soigneusement. C’est de cette façon que la découverte du paysage et du territoire a pu exister pendant cette marche. Nous n’étions ni l’un ni l’autre des randonneurs rodés à la nature mais plutôt des citadins qui prennent le métro pour une seule station. C’est ça qui fait la différence avec un raid classique. Si nous nous étions soumis à un entraînement préalable, ça serait revenu à prendre un train Nantes-Metz. On aurait été de stupides machines à avaler les distances.En un sens, on peut rapprocher vos performances de concepts qui ont été popularisés par la télé-réalité : Koh-Lanta, Fear Factor, Man vs Wild… Même si les enjeux sont à l’antithèse de ça : d’un côté, il y a l’appât du gain et le bénéfice matériel, de l’autre une gratuité totale et absurde du geste, une expérience purement existentielle.La télé-réalité est intéressante parce que c’est un principe de récit qui englobe du texte (je pense aux aveux dans le confessionnal deSecret Story) en alternance avec des images autour des mêmes événements. C’est un mode de reportage idéal. Sinon, les situations sont tellement écrites, les protagonistes tellement débiles que j’ai du mal à considérer ce médium comme « intéressant ». Pour l’instant, il est entre les mains de crapules alors que c’est une forme qui a le potentiel de véhiculer bien plus de sens qu’elle n’en a à l’heure actuelle.Tu peux nous en dire plus sur ta performance intitulée Verdun ?Ce n’était pas une performance mais une expo qui portait ce nom. Dans tous les récits, on parle de Verdun comme étant synonyme de boue, de massacres, d’explosions, de météo pourrie, de tranchées… La seule chose qui subsiste encore là-bas de tout ça et qui est immuable, c’est la boue – et le temps pourri. Dans chacun des projets que j’ai menés, la survie en milieu hostile et l’adaptation à l’environnement sont facilement comparables à des situations de conflit, pourtant je n’ai jamais été franchement belliqueux ni passionné par le phénomène guerrier. Ce qui me rapproche de Verdun, c’est surtout d’être, au cours de chaque projet, victime d’un contexte. Bien sûr, c’est sans commune mesure avec ce qu’ont vécu les soldats pendant la première guerre mondiale, mais la campagne environnant Verdun est toujours terrible pour quelqu’un de perdu. C’est resté un paysage qui dévore, une terre qui engloutit les hommes.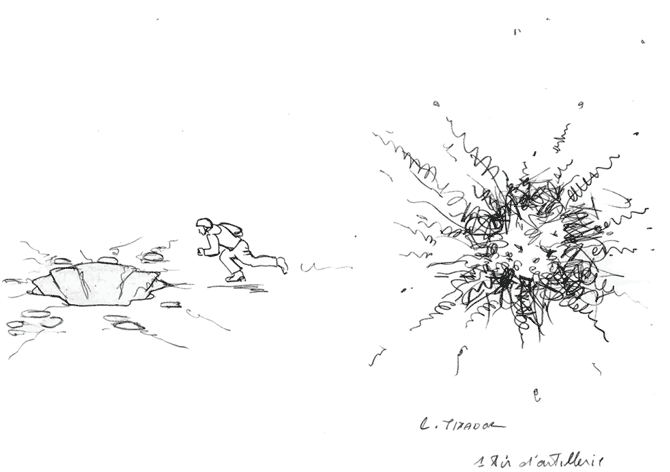 Une destination de rêve, en somme.Avec Abraham, nous y avons atterri deux fois, la première à pied, la seconde en vélo et nous y avons connu la boue, la pluie et l’angoisse. Ce qui était le plus étonnant, c’était cette sensation mystérieuse d’être enfin à notre place. De ne pas s’inquiéter du regard des habitants qui semblent considérer comme ordinaire qu’on affronte l’adversité. En un mot, qu’on vienne chez eux pour chercher la tristesse. En revanche, si on y va pour les vacances, on passe pour un excentrique. Quand on y est passés en vélo, on a décidé de stopper là le projet. De donner à notre périple le titre de « journal d’une défaite ». Sans le savoir, on était restés fidèles à cette vieille devise locale : « On ne passe pas. » On s’enfonçait trop profondément dans la terre et cette fois-là, ça nous a vaincus. On est rentrés en train.Ça renvoie une fois de plus à cette notion d’« échec » que tu sembles affectionner.En définitive, les alentours de Verdun sont une campagne qui a pris l’habitude de gober des victimes et c’est donc un adversaire de taille pour quelqu’un qui s’offre en pâture aux éléments. Passer à Verdun me retransforme en artiste. C’est comme si je me mettais à peindre une vanité.Comment s’est passée ta performance du « pois sauteur » dans le Jardin des Tuileries pendant la FIAC en 2009 ? Et surtout, comment as-tu eu l’idée de cette étrange construction en bois dans laquelle tu étais enfermé ?J’ai bêtement pensé que j’allais refuser cette invitation parce que le Jardin des Tuileries n’a rien à offrir de tout ce que je recherche. C’est un lieu hyper sécurisé où tout est sous contrôle. Un extrême dans la domestication. Puis en y réfléchissant bien, en tant que parc de sculpture temporaire pour la FIAC, il ouvrait des possibilités qui sont celles des œuvres d’art. Elles ont des droits qu’on enlève à l’espace public. J’ai invité les frères Chapuisat que je venais juste de rencontrer car ils ont l’habitude de réaliser des espaces contraignants. Ils ont pris visuellement la place qu’on m’a proposée et moi, j’ai trouvé un espace d’expérience.
Une destination de rêve, en somme.Avec Abraham, nous y avons atterri deux fois, la première à pied, la seconde en vélo et nous y avons connu la boue, la pluie et l’angoisse. Ce qui était le plus étonnant, c’était cette sensation mystérieuse d’être enfin à notre place. De ne pas s’inquiéter du regard des habitants qui semblent considérer comme ordinaire qu’on affronte l’adversité. En un mot, qu’on vienne chez eux pour chercher la tristesse. En revanche, si on y va pour les vacances, on passe pour un excentrique. Quand on y est passés en vélo, on a décidé de stopper là le projet. De donner à notre périple le titre de « journal d’une défaite ». Sans le savoir, on était restés fidèles à cette vieille devise locale : « On ne passe pas. » On s’enfonçait trop profondément dans la terre et cette fois-là, ça nous a vaincus. On est rentrés en train.Ça renvoie une fois de plus à cette notion d’« échec » que tu sembles affectionner.En définitive, les alentours de Verdun sont une campagne qui a pris l’habitude de gober des victimes et c’est donc un adversaire de taille pour quelqu’un qui s’offre en pâture aux éléments. Passer à Verdun me retransforme en artiste. C’est comme si je me mettais à peindre une vanité.Comment s’est passée ta performance du « pois sauteur » dans le Jardin des Tuileries pendant la FIAC en 2009 ? Et surtout, comment as-tu eu l’idée de cette étrange construction en bois dans laquelle tu étais enfermé ?J’ai bêtement pensé que j’allais refuser cette invitation parce que le Jardin des Tuileries n’a rien à offrir de tout ce que je recherche. C’est un lieu hyper sécurisé où tout est sous contrôle. Un extrême dans la domestication. Puis en y réfléchissant bien, en tant que parc de sculpture temporaire pour la FIAC, il ouvrait des possibilités qui sont celles des œuvres d’art. Elles ont des droits qu’on enlève à l’espace public. J’ai invité les frères Chapuisat que je venais juste de rencontrer car ils ont l’habitude de réaliser des espaces contraignants. Ils ont pris visuellement la place qu’on m’a proposée et moi, j’ai trouvé un espace d’expérience. Tes actions m’évoquent parfois les personnages filmés par Herzog. Des types ordinaires confrontés à des situations qui les dépassent complètement, qui doivent lutter pour leur survie et qui sont finalement obligés de capituler devant les forces de la nature.Des types ordinaires, peut-être, mais avant tout habités par une obsession violente. Ce sont des personnalités nourries par un seul objectif. Un objectif qui les dépasse, certes, et qui finit souvent par les détruire, mais qui paradoxalement les aide à vivre. C’est valable aussi bien pour Dieter Dengler dansRescue Dawnqui est prêt à tout, même à faire la guerre aux côtés des Américains dans l’unique but de pouvoir piloter un avion, que pour Timothy Treadwell dansGrizzly Man, dont la passion pour les ours finit par se retourner contre lui, ou pour le personnage joué par Klaus Kinski dansFitzcarraldo, littéralement prêt à déplacer des montagnes. Du point de vue de ces caractères, les enjeux sont simultanément vitaux et mortels. Ta comparaison me flatte, vraiment, mais je n’ai pas encore le niveau. J’y travaille.Tu sembles te situer en marge de ce que l’on appelle communément le « monde de l’art ». Les enjeux de tes performances sont loin du white cube. Tu sembles rechercher au contraire un état non civilisé au sein d’une société civilisée, comme une sorte d’auto-anthropologie.Loin du réseau et des mondanités, ça c’est certain. Je déteste les enjeux de ce milieu et du coup, j’y suis hyper mal à l’aise. Ma préférence va largement aux microcosmes que je me crée. Ça me désole pour ceux que je pourrais froisser en paraissant froid ou inamical mais une chose est sûre, c’est que je n’ai jamais été invité dans un lieu ou acheté par un collectionneur par relation. C’est d’ailleurs pour moi une fierté tout à fait ouvrière, que je revendique. Ça ne me dérange pas d’être un prolétaire de l’art ou même une sorte d’ouvrier chinois très lointain dont on ne peut connaître que la production. Tous ces univers que j’ai testés jusqu’à présent, ces états non civilisés, sont des propositions alternatives auwhite cube.Comment inscris-tu ta démarche dans l’histoire de l’art ? As-tu des artistes référents avec lesquels tu revendiques une certaine parenté ?Ce n’est pas mon travail de définir mes parentés ou ma place dans l’histoire de l’art. Je me suis amusé à m’inscrire dans l’histoire de la conquête polaire en devenant le premier artiste à fouler le pôle Nord géographique et c’est déjà suffisamment ridicule. Quant aux références, je ne les trouve pas forcément chez des artistes. D’ailleurs, le terme « référence » ne me convient pas. Je préfère dire que j’ai des héros, comme Werner Herzog dont on parlait, mais aussi Dennis Hopper, Marina Abramovic, Youri Gagarine et bien d’autres.
Tes actions m’évoquent parfois les personnages filmés par Herzog. Des types ordinaires confrontés à des situations qui les dépassent complètement, qui doivent lutter pour leur survie et qui sont finalement obligés de capituler devant les forces de la nature.Des types ordinaires, peut-être, mais avant tout habités par une obsession violente. Ce sont des personnalités nourries par un seul objectif. Un objectif qui les dépasse, certes, et qui finit souvent par les détruire, mais qui paradoxalement les aide à vivre. C’est valable aussi bien pour Dieter Dengler dansRescue Dawnqui est prêt à tout, même à faire la guerre aux côtés des Américains dans l’unique but de pouvoir piloter un avion, que pour Timothy Treadwell dansGrizzly Man, dont la passion pour les ours finit par se retourner contre lui, ou pour le personnage joué par Klaus Kinski dansFitzcarraldo, littéralement prêt à déplacer des montagnes. Du point de vue de ces caractères, les enjeux sont simultanément vitaux et mortels. Ta comparaison me flatte, vraiment, mais je n’ai pas encore le niveau. J’y travaille.Tu sembles te situer en marge de ce que l’on appelle communément le « monde de l’art ». Les enjeux de tes performances sont loin du white cube. Tu sembles rechercher au contraire un état non civilisé au sein d’une société civilisée, comme une sorte d’auto-anthropologie.Loin du réseau et des mondanités, ça c’est certain. Je déteste les enjeux de ce milieu et du coup, j’y suis hyper mal à l’aise. Ma préférence va largement aux microcosmes que je me crée. Ça me désole pour ceux que je pourrais froisser en paraissant froid ou inamical mais une chose est sûre, c’est que je n’ai jamais été invité dans un lieu ou acheté par un collectionneur par relation. C’est d’ailleurs pour moi une fierté tout à fait ouvrière, que je revendique. Ça ne me dérange pas d’être un prolétaire de l’art ou même une sorte d’ouvrier chinois très lointain dont on ne peut connaître que la production. Tous ces univers que j’ai testés jusqu’à présent, ces états non civilisés, sont des propositions alternatives auwhite cube.Comment inscris-tu ta démarche dans l’histoire de l’art ? As-tu des artistes référents avec lesquels tu revendiques une certaine parenté ?Ce n’est pas mon travail de définir mes parentés ou ma place dans l’histoire de l’art. Je me suis amusé à m’inscrire dans l’histoire de la conquête polaire en devenant le premier artiste à fouler le pôle Nord géographique et c’est déjà suffisamment ridicule. Quant aux références, je ne les trouve pas forcément chez des artistes. D’ailleurs, le terme « référence » ne me convient pas. Je préfère dire que j’ai des héros, comme Werner Herzog dont on parlait, mais aussi Dennis Hopper, Marina Abramovic, Youri Gagarine et bien d’autres.

Publicité
Publicité
Publicité

Publicité
Publicité

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
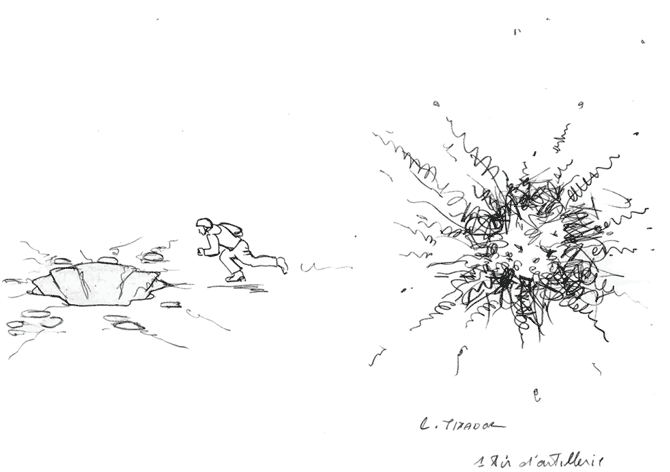
Publicité
