
C’est juste pour la photo ! Je déteste être pris en photo mais comme j’aime bien Vice, je me suis dit que j’allais jouer le jeu. C’est bien la première fois. En vrai, je ne suis pas un type armé. Je n’ai pas d’arme, je n’ai même pas de permis de port d’armes, rien du tout. J’utilise les armes seulement dans mes performances. C’est toi-même qui tires pour faire les dessins avec les impacts de balles ? Ça doit demander une précision de dingue…
Ouais, enfin, tu sais, c’est simple. Je tire presque à bout portant. La toute première fois que j’ai utilisé le tir, c’était pour l’inauguration du Palais de Tokyo en 2002. Je n’imaginais pas tirer moi-même, ce n’était pas adapté au projet. À l’époque, je m’intéressais beaucoup aux crimes d’État. Et donc, forcément, à l’affaire Mesrine. Bon maintenant, il y a eu des films, des biographies, on connaît l’histoire par cœur, mais à l’époque c’était presque tombé aux oubliettes. Ça faisait longtemps que cette histoire m’intéressait et j’avais fini par retrouver un des flics qui a tué Mesrine. C’était assez incroyable de tomber sur ce mec-là. Par hasard ?
Je ne l’ai pas cherché, disons que je l’ai rencontré. J’avais conçu cette pièce pour lui. Ce qui était intéressant, c’était qu’on partageait les mêmes interrogations. Il m’a confié que de toute sa carrière, il avait fait en sorte que ça n’arrive plus jamais. Lui-même trouvait ça anormal d’abattre comme ça quelqu’un en pleine rue. Ça n’est pas très glorieux pour la démocratie. En effet.
À l’époque, il était simple inspecteur, et quand je l’ai rencontré, il était commandant de la brigade criminelle de Paris. Je l’ai convaincu de tirer dans une palissade de bois pour y inscrire « Instinct de Mort », le titre de l’autobiographie de Mesrine qui a été censurée des milliers de fois. Mesrine, c’est quand même un type qui a été formé par l’armée et qui à un moment donné a sûrement bossé pour l’OAS ou les services secrets. Il y a un épisode qui n’est pas du tout raconté dans le film, c’est lorsqu’il cambriole un juge d’instruction sicilien. Il se fait choper en plein pendant le vol. Il est tout de même dans les bureaux d’un juge d’instruction, l’endroit intouchable par excellence. Il rentre par effraction, il vole un truc, il se fait choper par des carabiniers, il se retrouve entouré de flics. Et deux heures plus tard, il est libéré. On peut se demander qui le couvre à ce moment-là ! C’est ça qui m’intéressait. Et comment as-tu réussi à convaincre le flic de venir tirer au Palais de Tokyo ?
Quand il a demandé l’autorisation à ses supérieurs, on la lui a refusée. Le flic l’a fait contre son autorité. Il s’est engagé auprès de moi pour le faire, à condition que ce soit de manière strictement anonyme. Bon, maintenant il est à la retraite, je m’en fous. Combien de temps a duré la séance de tir ?
On a mis deux jours. Ça aurait pu mettre deux heures, mais il n’avait que deux armes à disposition. Moi, je chargeais les balles pendant qu’il tirait. Mais au bout d’une heure, les armes étaient tellement chaudes qu’on ne pouvait plus tirer ! Il a donc été obligé de revenir le lendemain. C’est dire à quel point il était motivé. Pourquoi il y tenait tant, à ton avis ?
C’était une forme d’exorcisme. Il avait envie de faire quelque chose autour de ça. Cette exécution de sang froid, ça lui a bouffé toute sa vie. Il n’en a jamais parlé après, il ne fallait surtout pas en parler. Avec moi, il l’a fait dans la mesure où j’ai respecté son anonymat. Quand as-tu commencé à réaliser ces grands tableaux en impacts de balles ?
Le tout premier que j’aie fait, c’était un panneau immense représentant une bataille navale qui se réfère à la bataille de Trafalgar, où la flotte britannique, des underdogs, en infériorité numérique, a attaqué par surprise les navires français. Ça fait 7 mètres de long et il y a 40 000 tirs. C’est avant tout une affaire de concentration. C’est cela qui m’intéressait, obtenir cette régularité du tir. Figurer l’administration Bush donne à ton travail un côté plus lisible, plus premier degré.
Oui, c’est sûr, c’était un peu le risque. J’essaie autant que possible de faire en sorte que mes pièces soient ambiguës, dans des dispositifs de perturbation subtils, alors que celles-ci sont plus frontales. Mais c’est ce qui m’a intéressé pendant un certain temps, cette frontalité fait aussi partie de mon travail, je l’assume complètement. Comme cette photo où je suis en train de tirer sur un avion B52. Oui, mais cette photo évoque un geste gratuit.
C’est vrai que dans les dessins, il y a un côté plus premier degré. Je voulais me restreindre à une série de portraits et ensuite passer à autre chose. Je place l’arme à feu dans une sorte de tautologie. Par exemple, Niki de Saint Phalle tirait à la carabine, mais c’était seulement pour produire des giclures de couleur, son œuvre ne traitait pas de la violence réelle, c’était juste une technique pour obtenir un effet esthétique donné.
Publicité

Pour moi, le portrait à deux mains gauches, c’est une pièce manifeste. J’étais en post-diplôme aux Beaux-Arts de Nantes et je ne connaissais pas d’artistes à l’époque. Dans ma promo, il y avait un paquet d’artistes qui ont fait du chemin depuis : Mathieu Mercier, Saâdane Afif, Pierre Malphettes, Bruno Peinado, Virginie Barré, Kristina Solomoukha… Quand j’ai vu que je m’engageais dans cette voie, j’ai regardé les artistes qui avaient travaillé de cette manière-là. Chris Burden a eu une influence sur moi, mais aussi pas mal d’artistes dans des positions radicales et assez premier degré qui adoptaient systématiquement une posture héroïque. Alors que moi, je n’étais pas du tout là-dedans, c’était même tout le contraire. Cette posture héroïque me faisait carrément flipper ! Au-delà de l’héroïsme, il y a une notion de mise en danger.
Mise en danger, pourquoi pas, mais certainement pas une posture de héros. D’ailleurs, cette photo à deux mains gauches est sous-titrée « Anti-Héros ». Je me suis dit que si je m’engageais dans cette voie-là, autant dédramatiser tout de suite ! J’en suis pas là, quoi ! Je sais que tu as eu des démêlés avec la brigade antiterroriste il y a quelques années, quand tu préparais Mike, non ?
C’est une histoire de point de vue. Pour dire clairement les choses, j’ai filmé un peu partout pendant deux, trois ans : il y a des prises au Moyen-Orient, à Washington, à Madrid, à Londres… Comme je m’intéresse beaucoup à tout ce qui tourne autour des notions de terrorisme, de manipulation, d’information… Dès que ça pète quelque part, j’y suis pas longtemps après. Le plot, c’est un type qui observe et qui fait son rapport. C’est lui qui tient la caméra. J’ai fait tout un travail sur la bande son, des voice over, des choses comme ça. Pour faire simple, c’est un peu le système Blair Witch. J’adore cette idée de document trouvé, ça a un potentiel énorme. Cela sous-tend une narration incomplète, un récit dont il manquerait des pièces.
Oui, voilà, ça fonctionne par ellipses. J’avais donc fabriqué ces faux rushes et ce faux personnage. Quand j’étais en postprod, en train de faire le montage à Bordeaux avec le musicien qui composait la bande son, j’ai subi une perquisition de la brigade antiterroriste et de la brigade criminelle, venues m’accuser d’un truc énorme. Quand il y a quinze flics armés qui déboulent chez toi au petit matin, c’est bien stressant. Je me suis très vite aperçu qu’ils avaient déjà fouillé dans mes affaires, qu’ils savaient exactement tout ce que j’avais, bref, qu’ils connaissaient toute ma vie. C’était hallucinant. Tu as un type qui arrive avec un dossier épais comme ça : « Alors, monsieur Declercq, le 12 mars, vous avez appelé telle personne. Qu’est-ce que vous lui avez dit ? » Qu’est-ce qui les a poussés à enquêter sur toi ?
C’est difficile à dire. Ils m’ont laissé entendre que c’était une dénonciation. Ce qui est sûr, c’est qu’ils avaient beaucoup de pièces concernant ma vie : déplacements, billets d’avion… Mais surtout, si on enlève le pathos du truc, je me disais : c’est incroyable ! J’essaye de construire un personnage, de valider son existence et des spécialistes viennent me dire qui est ce mec ! Ils sont facilement tombés dans le panneau.
C’est très étrange, oui. J’ai compris quelque chose ce jour-là : je savais que la fiction se nourrissait de la réalité. Pour n’importe quel téléfilm TF1 à la con, tu as toujours un flic qui est là pour amener du crédit à la fiction. Mais l’inverse est vrai, j’avais l’impression d’être dans un film. Déjà, tous les flics étaient en civil, dans une toute petite pièce. Et puis, ils ont des stratégies totalement déstabilisantes. T’en as un qui vient te taper sur l’épaule en te disant : « C’est rien, ils ont aucune charge contre toi. » Et tout de suite après, on te secoue un peu, on te gueule dessus du genre : « Allez, arrête tes conneries, maintenant tu craches le morceau ! » Quels étaient leurs chefs d’accusation ?
J’ai réellement été suspecté d’être le chaînon manquant entre Al-Qaida et l’ETA espagnol ! Rien que ça.
Ils pensaient même que j’étais l’intermédiaire de financement entre les deux. En tout cas, ils orientaient leurs questions autour de ça, surtout les mecs de la brigade antiterroriste, ils venaient de Bayonne, c’étaient des spécialistes de l’ETA. Très vite, j’ai senti qu’ils ne croyaient pas deux secondes à cette histoire. Mais faut savoir qu’être artiste, journaliste ou humanitaire, c’est une bonne stratégie de couverture, ça t’autorise à faire plein de choses, c’est beaucoup utilisé par les terroristes et encore plus par les services secrets. Oui mais précisément, si tu te sers du fait d’être artiste comme d’une couverture, tu ne vas pas attirer l’attention en montrant un boulot qui traite du terrorisme. Ce serait débile.
C’est ce que je leur ai expliqué ! Et quand tu as maquillé une Citroën Évasion en voiture de flic, tu n’as pas été interpellé ?
Non, là, aucune difficulté. C’était au début des années 2000 et il y avait une vraie bagnole de flic qui circulait dans Paris. J’adorais le cul de cette voiture où étaient inscrits à la fois « Police » et « Évasion ». Jusqu’au jour où je me suis dit : je vais faire un fac-similé de cette voiture pour une exposition au Centre d’art de Brétigny. L’idée était de prendre une voiture civile, de la maquiller en voiture de flic et que les gens puissent l’emprunter pendant l’expo. Autant te dire que peu de gens l’ont empruntée, vu que tu risques sept mois de prison ferme et 7 000 euros d’amende. Certains ont tenté le coup, je crois.
Il y en a eu six. C’est déjà pas mal ! Au départ c’était une blague. Ça m’intéressait aussi de savoir dans quelle mesure les centres d’art sont des zones non pas de « non-droit », mais plutôt de « plus de droit ». D’une manière générale, les libertés dans le quotidien sont de plus en plus restreintes. Dans les musées et les centres d’art, à l’inverse, il y a une grande tolérance. La seule contrainte pour moi, c’était de mettre une affiche à côté qui disait : « Ceci n’est pas une voiture de police mais une œuvre d’art. »

Oui, carrément. Ça a longtemps été uniquement contextuel, comme ce que j’ai fait au Transpalette. À l’époque où j’y ai exposé, il y avait quand même quinze employés alors que c’est un squat. Au moment où j’y étais, cinq d’entre eux étaient encore sous contrôle judiciaire. Quasiment tous étaient passés par la prison, pas mal d’anciens toxicos, etc. C’est là-bas que tu as tourné Escape, non ?
Oui, ça faisait longtemps que j’avais envie de filmer l’évasion d’une prison. Le lieu était parfaitement adapté, tant par l’architecture que par les gens qui s’en occupaient. J’ai donc construit une prison dans la salle d’expo. C’était comme un décor de cinéma. On a bossé comme des dingues pendant quinze jours, à trimballer des tonnes de métal, à souder de partout, à tout sécuriser comme une vraie prison. Et deux jours avant l’expo qui s’appelait « Panoptique », j’ai filmé une évasion par hélicoptère. Finalement, tu travailles sur toutes les zones de tension dans le monde.
J’étais en résidence en Corée du Sud il n’y a pas longtemps. J’y étais allé il y a quatre, cinq ans et j’avais visité un endroit incroyable à la frontière de la Corée du Nord qui s’appelle le Troisième Tunnel. Déjà, s’il s’appelle comme ça, c’est qu’il y en a déjà eu deux avant. En fait, c’est les Nord-Coréens qui ont essayé d’envahir la Corée du Sud dans les années 1980 en creusant un tunnel, mais alors un putain de tunnel ! Ça fait 14 km de long, 100 mètres de large. Et il n’a jamais été rebouché ?
C’est exactement ça qui m’intéressait. Les Nord-Coréens se sont fait dénoncer alors qu’ils avaient creusé un bon bout de chemin, ils ont été contraints d’arrêter pour éviter les représailles. Mais au lieu de le reboucher, la Corée du Sud a creusé la suite ! Un truc super clean, comme une entrée de garage sur 3 km et t’arrives à une grille frontalière, juste à l’entrée du tunnel nord-coréen. La Corée du Sud, c’est comme toutes ces frontières où l’on sent une tension énorme, comme la frontière Inde-Pakistan, il y a des incidents et des morts régulièrement, des militaires en pagaille… C’est vraiment des lieux de tension énorme et en même temps, on dirait des parcs d’attractions. Tu t’es démerdé comment pour la photo ?
La première fois, je m’étais fait choper par les militaires, la pelloche, tout. J’étais dégoûté. Je me suis dit : « Cette année j’y retourne, je vais y arriver. » Donc j’ai réussi à sortir l’image et la directrice du musée qui m’avait invité m’a dit qu’il n’y avait pas de problème pour la montrer. Tu vois, les centres d’art restent des lieux de liberté. Cette liberté-là n’est-elle pas toute relative ? J’ai entendu quelqu’un dire, un jour : « L’art, c’est des idées de gauche vendues à des gens de droite. » C’est pas faux.
Il y a peu de mes pièces dont je peux évacuer la dimension politique, du moins le contexte politique. Si tu es vraiment en désaccord avec ce que je fais, tu n’achètes pas mon boulot.
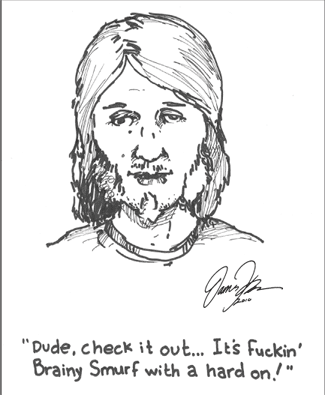
Ah ah oui, ça doit être ça ! En même temps, il faut être réaliste, je suis pleinement inscrit dans le marché de l’art. Je bosse avec des galeries, avec des centres d’art, je vends à des collectionneurs ou à des institutions à des prix énormes. Je ne vends pas grand-chose, mais ce que je vends, c’est cher. Oui, il faut bien manger, hein.
À partir du moment où j’accepte ces règles du jeu, je sais que je me coupe d’un public énorme. Si la moindre de mes photos coûte 5 000 ou 6 000 euros, qui peut s’acheter ça ? C’est forcément des gens qui ont beaucoup de pognon. Il faut être réaliste. J’imagine que ce sont des passionnés d’art qui achètent tes pièces.
Oui, c’est ça. Souvent, ce sont des gens friqués, mais pas non plus des milliardaires. Et puis, tu as des rencontres incroyables. Le mec qui m’a acheté la photo où je tire sur un B52, c’est un avocat d’affaires avec des entreprises américaines au Luxembourg, l’archétype du type dont tu te méfies. Il m’a dit : « Je veux t’acheter ton image pour la mettre dans la salle d’attente de mon bureau, comme ça tous les mecs qui vont arriver, ils sauront d’emblée de quoi on va parler. » Et en Corée, c’était comment ?
Ça se passait dans un lieu appelé Kimusa, dans l’ancien QG des services secrets coréens. C’est l’équivalent de la Biennale de Séoul. Ils changent de lieu tous les ans et cette fois, ils ont investi l’ancien bâtiment et ont demandé à quelques artistes de travailler dans ce contexte. Du coup, je suis resté un mois là-bas, et le lendemain du départ des services secrets, je pouvais me balader dans le bâtiment. J’ai pu choisir les salles où j’exposais et j’ai découvert des salles entièrement capitonnées, ça puait la mort là-dedans. J’ai fait une installation contextuelle dans la salle des archives. T’as pas eu d’emmerdes cette fois-là ?
Non, pas cette fois ! Mais tu sais, je n’en ai pas si souvent que ça. C’est juste que quand j’en ai, elles sont grosses. Il n’y a ni dogme ni morale dans mon travail. Il y a même des militaires qui sont fans de ce que je fais. Il y en a un qui est venu voir mon expo et qui m’a sorti : « Moi, je tire toute la journée et toi, tu t’en sers pour faire des dessins ! C’est génial ! Je peux venir tirer avec toi un de ces quatre ? » Sérieux.